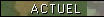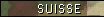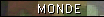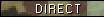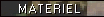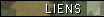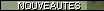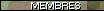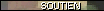Les médias et le médiévalisme, ou le pouvoir tyrannique d'une caste cosmopolite
20 décembre 2004

’essayiste et journaliste américain Robert Kaplan a mené une réflexion de fond sur la place et le rôle des médias au sein de nos sociétés. Il en conclut que les journalistes tendent à devenir les inquisiteurs de notre ère, et que les médias détiennent aujourd’hui une puissance tyrannique.
« La tyrannie la plus criante est celle qui pose les questions les plus criantes », écrit Elias Canetti, lauréat du Nobel, dans Crowds and Power (1960). Canetti, un Bulgare de descendance hispano-juive, a été témoin des violences populaires liées à l’inflation qui ont saisi Francfort et Vienne pendant l’entre-deux guerres. Il a consacré son énergie littéraire à l’étude des masses humaines. Dans la foule, Canetti voyait une bête sauvage et dangereuse qui, indignée par la perception sa propre oppression, détenait le pouvoir suprême d'opprimer. Il discernait 6 ingrédients nécessaires à l'oppression : le secret, la brutalité physique, la réaction rapide, le droit d'interroger et d'exiger des réponses, le droit de juger et de condamner, ainsi que le droit de pardonner et faire preuve de clémence.
J'ai lu Crowds and Power en Roumanie, en 1984, et je l'ai mis en relation avec le totalitarisme communiste qui illustrait autour de moi le travail inachevé de la Seconde guerre mondiale. Ce que je voyais me rapprochait de l'une des obsessions de Canetti : la manipulation de la foule sous sa forme à la fois concrète et virtuelle. Ce qui était fascinant, ce n'est pas la morne réalité de la tyrannie exercée par Nicolae et Elena Ceausescu, mais la psychologie de masse qui l'englobait, y compris les énormes rassemblements pro-Ceausescu auxquels j'assistais et qui mobilisaient par bus et trains entiers des paysans amenés de la campagne pour remplir les places.
Après la chute du Mur de Berlin, je l'ai relu et j'ai remarqué que plusieurs ingrédients de Canetti étaient également les outils de régimes légitimes cherchant à tenir à distance l'anarchie des foules. Mais lire aujourd'hui Crowds and Power, à une époque où les régimes autoritaires vraiment nocifs sont de plus en plus rares, revient à être frappé par une autre réalisation.
Une nouvelle tyrannie
Alors que plusieurs régimes – notamment au Moyen-Orient – emploient le secret et la brutalité invoqués par Canetti comme leurs moyens de contrôle ordinaires, ce dernier est bien plus intéressant lorsqu’il décrit le pouvoir d’interroger et d’exiger des réponses, de juger et de condamner, de réagir rapidement et de pardonner. Après tout, le secret et la brutalité sont des éléments de contrôle si évidents qu’ils n’exigent pas de grandes explications.
Mais écoutez-le parler d’un autre élément : « Toute interrogation est une intrusion forcée… L’interrogateur sait ce qu’il y a à trouver, mais il veut en fait le toucher et l’amener à la lumière du jour. Il se met à travailler avec la sûreté d’un chirurgien qui… stimule la douleur… La situation est la plus dangereuse pour la personne interrogée lorsque des réponses brèves et concises sont exigées… »
Canetti mentionne également les enquêtes judiciaires, mais celles-ci sont à présent menées le long de limites sévèrement prescrites, avec la présence d’un juge et d’un avocat pour protéger les droits de la personne interrogée. C’est plus loin, lorsqu’il discute le pur « plaisir » que les gens au pouvoir prennent à « prononcer un verdict défavorable » – sur « un mauvais peintre » ou « un mauvais politicien », soit d’après Canetti « un mauvais homme » – qu’apparaît l’idée spécifique d’une tyrannie à la nature changeante.
L’oppression trépidante qui saisissait de larges portions de la planète voici 15 ans n’existe presque plus. Pendant ce temps, à travers l’Occident post-industriel, les élections sont des événements étrangement manipulés, indistincts des campagnes publicitaires commerciales, où les candidats font régulièrement des déclarations qui sont de toute évidence hypocrites et complètement fausses, mais qui sont essentielles à l’apaisement de millions de votants sur des problèmes hautement émotionnels. Comme le romancier autrichien Robert Musil l’a furtivement glissé dans The Man Without Qualities (1952), le monde adore les propos trompeurs, et les politiciens les plus malins intègrent profondément cette réalité. La citoyenneté exaltée de la démocratie n’est rien de plus qu’une autre masse humaine de Canetti.
Mais peu de politiciens sont assez malins pour percevoir précisément les fluctuations quotidiennes de la passion populaire, et ceux qui le sont – en raison de leur subtilité – trouvent en général plus sage de céder à ces fluctuations plutôt que mener la foule sur une voie plus ardue. Comme même nos meilleurs politiciens sont amadoués par la meute électorale, nous devons examiner un autre groupe pour trouver la vraie source de puissance à notre ère.
Nous vivons à un âge où nous sommes bombardés par des messages qui nous disent quoi acheter et quoi penser, et lorsque l’on dissèque les vrais éléments de la puissance, qui la détient et – plus important encore à une époque de changements rapides – qui l’obtient de plus en plus, on est amené à conclure froidement que notre ère n’est pas celle de la démocratie, ou du terrorisme, mais celle des médias de masse, sans lesquels le genre actuel de terrorisme serait totalement impuissant.
Comme les prêtres l’Egypte antique, les rhétoriciens de la Grèce et de la Rome antiques, et les théologiens de l’Europe médiévale, les médias représentent une classe de gens brillants et ambitieux dont la stature sociale et économique leur donne une influence permettant d’affaiblir l’autorité politique. Tout comme ces groupes précédents, les médias ont un pouvoir politique authentique – terriblement magnifié par la technologie – sans la redevabilité bureaucratique qui l’accompagne souvent, de sorte qu’ils ne sont jamais coupables de ce qu’ils préconisent.
Si par exemple ce qu’un commentateur particulier a recommandé tourne mal, le mégaphone permanent qu’il manie au-dessus de la foule lui permet d’expliquer différemment sa position – en un article ou une apparence télévisée, ou davantage – avant de changer de sujet parmi le flux rugissant des nouveaux événements. Les présidents, même si les électeurs ignorent leurs gaffes, sont au moins responsables devant l’histoire ; les journalistes le sont rarement. Cette liberté est la clef de leur pouvoir irresponsable.
Il n’y a rien d’irresponsable en soi à rendre publiques ses propres opinions. En fait, les gouvernements seraient pires sans expert qu’avec un surnombre d’entre eux. Sous une forme ou une autre, les érudits ont toujours joué un rôle dans les sociétés libres. Mais la centralisation en cours des grands médias, la magnification de leur influence par l’entremise de divers moyens électroniques et l’intensité en hausse du spectacle offert par les grandes télévisions à écran plat ont créé un nouveau règne autoritaire comparable à l’émergence d’une superpuissance, avec des conséquences géopolitiques tout aussi profondes.
Si par exemple que Fox News venait à ajuster le ton de sa couverture, ne serait-ce que pour le motif pécuniaire de voler quelques téléspectateurs de gauche à CNN, ou si le New York Times venait à mettre à la retraite quelques uns de ses éditorialistes afin de publier une page d’opinion moins lassante et moins hystérique, les ramifications ne seraient pas uniquement journalistiques mais également politiques, et peut-être suffisantes à l’avenir pour affecter le résultat d’une élection serrée.
Mais les médias ne sont pas les agents de la décentralisation de l’autorité, qui implique une sorte de transformation saine et ordonnée. Ils sont plutôt les agents de son affaiblissement. Les compromis cyniques de plus en plus nécessaires aux politiciens, pour surnager dans un environnement régenté par les médias, les immobilisent encore plus. Les politiciens sont plus faibles que jamais, et les journalistes plus forts. Exprimer régulièrement son opinion à la télévision revient à être, comme ils disent, accompli ; être l’assistant ou le vice-assistant du Secrétaire d’Etat, de la Défense, de l’Agriculture ou du Commerce – des postes qui exigent des niveaux bien supérieurs d’expertise et de gestion du stress – signifie souvent glisser dans l’oubli, pour un salaire nettement inférieur.
Le Moyen-Age était tyrannisé par l’exigence d’un perfectionnisme spirituel, empêchant d’accomplir quoi que ce soit de concret. La vérité, avertissait Erasme, doit être dissimulée sous un manteau de piété. Machiavel se demandait si un Gouvernement pouvait rester utile s’il se mettait à pratiquer la moralité qu’il prêchait. Aujourd’hui, les médias globaux posent des exigences envers les généraux et les politiciens qui nécessitent une catégorie de perfectionnisme avec laquelle les autorités médiévales seraient familières. Les journalistes d’investigation peuvent souvent distribuer les louanges, mais ils sont également devenus les grands inquisiteurs de notre ère, brisant des réputations construites pendant toute une vie avec la révélation de quelques détails sordides.
Quand la rédaction d’une émission comme 60 Minutes décide quel sujet doit être poursuivi et quel autre doit être abandonné, le destin d’un certain nombre de personne est tranquillement en train de se jouer. Cela forme une autorité réelle et non virtuelle, quel que soit le degré de responsabilité avec laquelle elle est employée ; une autorité souvent plus forte que celle de n’importe quel député ou sénateur. Et comme les goûts éditoriaux des tabloïds se mêlent à ceux de l’ensemble des médias, le rythme de la destruction des personnages s’accélère.
La chaîne télévisée cosmopolite
L’élite médiatique se flatte de perpétuer la tradition du journalisme d’investigation héritée du début du XXe siècle. Mais sur le plan chronologique comme philosophique, le journalisme d’investigation est tout autant un héritage de la rébellion menée dans les années 60 par la jeunesse, pendant laquelle, comme Samuel Huntington l’a écrit dans son meilleur livre, American Politics: The Promise of Disharmony (1981), « l’arrogance de la puissance a été supplantée par l’arrogance de la moralité. » Lorsque secret est devenu synonyme de néfaste à la fin des années 60, la technique de la dénonciation a été élevée au rang de principe.
Dans Shield of Achilles: War, Peace, and the Course of History (2002), l’académicien Philip Bobbitt développe cette notion. Il observe que « dans l’Etat-marché, les médias ont commencé à agir en compétition directe avec le Gouvernement en place. » Les médias « sont plus agiles que les bureaucraties entravées par les règles procédurales », alors même qu’ils sont « protégés dans de nombreux pays par des statuts et des amendements constitutionnels. » Il ajoute que la « fonction décisive des médias dans l’Etat-marché est similaire à celle des partis politiques de gauche dans l’Etat-nation. » Bobbitt n’affirme pas ici que les médias penchent à gauche. Pour ce que l’on en sait, il pourrait croire qu’ils sont devenus, à certains égards, dangereusement de droite.
Non, Bobbitt nous mène sur la voie d’une idée différente, selon laquelle le rôle essentiel de la gauche a toujours été d’interpeller et de dénoncer l’autorité. Car c’est la crainte de l’autorité, propre à la gauche, qui entraîne son malaise avec le concept de leadership. Les gens de gauche écrivent rarement des livres sur le leadership et la responsabilité : c’est l’apanage du genre commercial et militaire. Les dirigeants doivent choisir, et parce que même les bons choix peuvent produire des résultats imparfaits, il y aura toujours matière à critiquer – et à dénoncer. Ainsi, les journaux de gauche peuvent être brillants bien qu’en définitive irresponsables. Et alors que l’Etat-nation meurt lentement et que les forces du marché mettent hors jeu la gauche traditionnelle, suite à la défaite du communisme, sa fonction doit être assumée par un nouvel acteur historique.
Pour autant que la gauche soit toujours vivante, je suggère qu’elle s’est transformée en quelque chose d’autre. Si ce qui était connu comme l’Internationale Communiste possède grosso modo un équivalent contemporain, alors les médias globaux forment celui-ci. Leurs exigences de paix et de justice, qui coulent de manière subliminale comme une substance intraveineuse à travers leurs reportages, est moraliste plus que morale – comme les appels enflammés de l’Internationale Communiste envers les droits des travailleurs. La paix et la justice sont des principes tellement généraux et évidents qu’il suffit de les invoquer à peine. N’importe quel sens toxique peut fleurir en eux ou les manipuler, si la rhétorique adéquate est adoptée. Pour les moralisateurs, ces principes sont une question de forme et non de contenu. A les en croire, Kofi Annan ne se trompe jamais.
Malgré cela, CNN – et notamment CNN International – ne peut pas être simplement définie comme une chaîne de gauche. Regardez les présentatrices exotiques de celle-ci, tellement chics et délicatement maquillées. Rosa Luxemburg n’a jamais ressemblé à cela. CNN International est une chaîne globale cosmopolite, tout comme Fox News est une chaîne d’un Etat-nation à l’ancienne, rehaussée par les dernières technologies. Le cosmopolitisme global est un monde de détenteurs de passeports multiples, de gens dont l’activité et le revenu donnent accès à de nombreux pays, même s’ils ont de moins en moins d’enjeux dans l’un d’entre eux en particulier.
De même que les journalistes ne sont pas bureaucratiquement redevables de leurs avis, les cosmopolites globaux sont de moins en moins redevables de l’espace géographique, ou d’un Gouvernement spécifique, ou même de leurs concitoyens électeurs. Leurs amis et leurs connaissances sont dispersés sur toute la planète, et le manque d’intérêts géographiques les rend sourds aux appels de l’intérêt national, mais réceptifs à ceux de « l’humanité ». A dire vrai, ce sont des bien-souciants. Comme Somerset Maugham l’a noté dans The Moon and Sixpence (1919), l’indignation morale contient toujours un élément d’autosatisfaction.
L’arme principale des médias globaux, comme de tout média, est la dénonciation. Après tout, il y aura toujours quelque chose de blâmable à exposer même dans les Gouvernements et les bureaucraties les plus efficaces, puisque de telles organisations sont par nature suprêmement imparfaites. Bien entendu, trop de dénonciations peuvent immobiliser le Gouvernement, mais si vous n’avez pas d’intérêt concret dans un endroit donné, cela importe peu. Le simple fait de dénoncer – et la satisfaction morale qui en découle – relève selon Canetti du plaisir.
La dénonciation est le terrain spécifique du journaliste d’investigation. C’est lui qui a hérité du manteau de la vieille gauche, quelle que soit l’inclination idéologique des individus pratiquant cette activité. Le journaliste d’investigation n’est jamais intéressé aux 90% des choses qui vont bien, ni spécialement aux 10% qui vont mal, mais seulement au 1% qui sont moralement répréhensibles. Parce qu’il semble toujours définir les institutions même les plus héroïques d’après leurs pires iniquités, sa cible n’est autre que l’autorité. Malgré ses dénégations, il est l’âme incarnée de la gauche.
Lorsque chaque grande décision de politique intérieure ou chaque opération militaire majeure est caractérisée d’après ses pires défauts, les dirigeants prennent de moins en moins de risques, car ils savent toute décision même vaguement épique sera par définition travestie en un échec jusqu’au jour où aucun bénéfice électoral ne pourra plus en être tiré. Il a fallu une génération pour que le Président Gerald Ford soit respecté pour avoir amnistié Richard Nixon – un acte qui a contribué à garantir la paix domestique même s’il a pu coûter à Ford une élection.
De fait, non seulement Ford a lui-même été absous par les médias, mais apparemment il en va aussi de la sorte pour les présidents Ronald Reagan et George Bush père – deux hommes que les médias avaient l’habitude de clouer au pilori. Qui sait, avec l’acquittement des médias, il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant que Bush père ou même Ford commencent à apparaître sur les listes des présidents modérément grands établies par les historiens. Canetti le savait : juger, condamner puis pardonner, voilà le vrai pouvoir !
Il faudra davantage de temps pour que l’on réalise peu à peu que Ford a été notre plus grand ex-président contemporain. Car à l’âge des médias de masse, où la divinité dépend de l’attention de la foule et où être oublié est l’équivalent de l’excommunication, la hauteur de caractère est définie par la volonté d’accepter l’obscurité dès l’instant où l’on abandonne une responsabilité bureaucratique imposante.
Le présentateur désincarné
La divinité a certainement été redéfinie par notre époque. A l’instar des saints figurant sur les icônes médiévales, qui étaient adorés avec de l’encens et des chandelles à partir de 500 après J.-C., les présentateurs télévisés sont, selon les termes du critique artistique et social John Berger, « l’archétype de la désincarnation. » Berger note dans The Shape of a Pocket (2001) « qu’il a fallu au système de nombreuses années avant de les inventer et de leur apprendre comment parler. » Le résultat pour le téléspectateur, suggère-t-il, n’est pas une impression de liberté, ou d’une élévation par l’information, mais son exact opposé : « une isolation profonde » et une impression de vide devant des esprits pareillement éloignés. C’est une variante pathologique du culte religieux.
Allez dans n’importe quel aéroport, où vous êtes rarement hors de portée sonore d’une chaîne d’information en continu, et quand vous l’êtes, ce sont les sous-titres qui vous prennent d’assaut. Vous réalisez que l’oppression provient du fait d’être forcé de prêter attention ; ou, à cet égard, forcé de susciter l’attention. Si la civilisation est construite sur un désir d’intimité et d’un peu de silence, alors les médias sont un bruit irrépressible. Entre ce bruit et vous gît une désolation mêlée de claustrophobie, au fur et à mesure que le monde qui vous entoure est réduit à une voix plaintive et désincarnée, qui prend les dimensions d’une prison.
Comme les hommes d’église médiévaux, la classe médiatique des bien-souciants a tendance à confondre la moralité avec la moralisation : ceux qui ont les mégaphones les plus forts et aucune redevabilité bureaucratique tendent à adopter des absolus moraux. Après tout, il est plus facile de transcender la politique que de s’y engager, avec tous les compromis moralement insatisfaisants que cela implique.
A les en croire, certains de nos correspondants les plus prestigieux ont occasionnellement remarqué que leur unique favoritisme est envers les faibles ou les victimes d’une crise. Cela peut convenir à l’église, mais pas nécessairement mener à une analyse de qualité. Comme l’a indiqué Musil, les banquiers sont plus honnêtes que les anges, parce que l’envie de richesse préserve davantage la pensée critique que l’envie d’amour. Dans tous les cas, la faiblesse définit un rapport de forces, et non un attribut moral. Si un camp est plus faible que l’autre, ou compte plus de victimes, cela ne signifie pas nécessairement que sa cause est juste, ou même morale, mais plutôt qu’il a commis une erreur militaire ou adopté une ligne plus cynique envers ses propres civils.
Les victimes doivent recevoir une assistance humaine, sans que leur camp engagé dans un conflit doive obtenir un appui politique par l’intermédiaire d’une couverture médiatique favorable. Dans un essai sur l’antisémitisme croissant en Europe, le philosophe français Alain Finkielkraut met en garde ceux qui manifestent une « sollicitude infaillible » envers ceux qui commettent « des actes répréhensibles » uniquement parce que de tels actes découlent de l’exploitation et de l’oppression. Les cibles de ses critiques sont les élites européennes en général, et non les médias globaux, mais les unes et les autres se chevauchent.
Parce que les médias confondent la victimitude avec le droit moral, les soldats américains en Irak ont occasionnellement été confrontés à une couverture médiatique hostile, qui à l’âge des médias de masse a des conséquences tactiques et stratégiques concrètes. Le printemps dernier, j’ai accompagné la première division de US Marines à Falloujah. Après plusieurs jours de combats intenses, les Marines – renforcés par un bataillon supplémentaire – semblaient sur le point de battre les insurgents. Un cessez-le-feu a cependant été ordonné, transformant en défaite une victoire toute proche.
Peu importe que les Marines se soient battus proprement, ce n’était pas assez propre pour les médias globaux, en particulier la fameuse Al-Jazeera, qui a décrit comme une tuerie indiscriminée ce qui en d’autres ères de conflit aurait constitué un faible taux de pertes civiles. Le fait que les mosquées étaient ouvertement utilisées par les insurgents comme postes de commandement pour des opérations militaires agressives importait moins aux journalistes que le ciblage de certaines de ces mosquées par l’aviation américaine. Si les combats avaient continué, les retombées politiques d’une telle couverture auraient contraint les nouvelles autorités irakiennes à démissionner en masse.
Les responsables américains n’avaient donc pas d’autre choix que d’affaiblir leur position de plus en plus favorable sur le champ de bataille en acceptant un cessez-le-feu. Bien que la politique américaine ait fauté par incohérence, en ordonnant un assaut d’envergure pour ensuite le suspendre, les Marines ont moins été battus par les insurgents que par la manière avec laquelle le combat urbain est couvert dans des médias globaux qui ont embrassé le culte de la victimitude.
Ce culte est un autre héritage des années 60 et de leur suite immédiate, lorsque selon Peter Novick dans The Holocaust in American Life (1999), les Juifs, les femmes, les noirs, les Indiens d’Amérique, les Arméniens et d’autres ont renforcé leur propre identité par des références publiques à une oppression passée. Le processus était lié au Vietnam, une guerre durant laquelle les photographies de victimes civiles – la petite fille fuyant le napalm – « ont remplacé les images traditionnelles d’héroïsme. » Il a désormais été retourné contre les Forces armées américaines. Lorsqu’ils ne leur donnent pas les traits de criminels impliqués dans des maltraitements scandaleux infligés à des prisonniers, les médias préfèrent décrire les soldats américains comme étant eux-mêmes des victimes – victimes d’une politique irakienne ratée, d’un mauvais système de réserve et d’une société qui les a transformés en assassins.
Toutefois, les soldats et les Marines des unités de combat avec lesquels j’ai passé des mois comme journaliste incorporé trouvaient profondément insultante cette couverture. Alors que les actes de courage sur les champs de bataille tels que Falloujah ou Najaf auraient, selon l’expert militaire John Hillen, « donné à Black Hawk Down des airs de Gosford Park », la couverture médiatique des militaires individuels comme guerriers héroïques reste pour l’essentiel absente. L’héroïsme de quelqu’un comme Jessica Lynch est acceptable pour la horde journalistique, parce qu’il est lié à sa victimitude. Il y a des exceptions : les comptes-rendus de Pat Tillman, qui a quitté la Ligne Nationale de Football pour devenir un Ranger et qui a été tué en Afghanistan, en sont un exemple. Mais toute analyse sérieuse nécessite une généralisation, et mettre en évidence des exceptions – une méthode que les médias pratiquent adroitement lorsqu’ils sont l’objet de critiques – ne constitue pas une réfutation.
Célébrer l’héroïsme militaire ne revient pas à glorifier la mort. La guerre est un triste fait de l’existence, mais reste un fait. Etre héroïque peut être une preuve de caractère plutôt que d’un goût sanguinaire. De plus, les Forces armées américaines – actives en permanence dans des dizaines de pays et combattant le terrorisme loin des grands titres – fournissent l’armature sécuritaire pour une civilisation globale émergente dont les institutions sont encore immatures. Et si elles emploient une large gamme de méthodes – y compris l’aide humanitaire – dans la lutte contre le terrorisme, l’usage de la force reste essentiel à cette entreprise. Al-Jazeera, un organe de télévision quasi indépendant, est elle-même le produit de la libéralisation trépidante de la société moyen-orientale, dont une partie du mérite revient aux Forces armées US.
Pourquoi devraient-ils se battre ?
Pendant la Seconde guerre mondiale, les soldats et les journalistes américains appartenaient au même milieu, et la couverture des médias était plus empathique. Elle transformait les militaires en héros lorsque les faits l’exigeaient, ce qui était fréquent. Mais les soldats ont moins changé que les journalistes. Le milieu auquel ces derniers aujourd’hui appartiennent est celui des médias globaux – une foule humaine transnationale à haut revenu. Ceci n’est pas une expression du caractère, bon ou mauvais, ou même de l’inclination personnelle. C’est la marque de profondes transformations sociales et économiques au niveau planétaire qui érodent l’Etat-nation, avec des migrations de réfugiés au bas de l’échelle des activités humaines et une classe prospère de cosmopolites globaux à son sommet. Les organes médiatiques et intellectuels prestigieux en sont venus à constituer une influence majeure dans le changement des rapports de force internationaux.
Dans Le Sursis (1945), Jean-Paul Sartre a suggéré que ce qui sépare les nantis de la classe laborieuse est le fait que celle-ci n’abandonne jamais. Elle se bat aussi longtemps qu’il le faut, non pas qu’elle n’ait aucun doute, mais parce que ne pas se battre la condamnerait à une autre labeur physique épuisant. En ce qui concerne la classe moyenne et au-dessus, « Pourquoi devraient-ils se battre ? Ils n’attendaient rien, ils avaient tout ce qu’ils voulaient. » Cela explique peut-être pourquoi les élites médiatiques imaginent que tout ce qui dégénère en affrontement doit correspondre ipso facto à un scandale. Un scandale de planification dévoyée et erronée est possible. Mais cela ne démontre pas que la lutte n’en vaut de toute manière pas la peine, et que faire preuve de caractère ne signifie pas voir à travers les choses et célébrer l’action héroïque dans ce processus.
Comme les médias confondent l’héroïsme du combat avec la glorification du meurtre et la victimitude avec la moralité, il ne reste qu’Al-Qaïda et cie pour vénérer les vieilles vertus guerrières. Je ne toutefois pas inquiet. Comme Stendhal l’a écrit dans La Chartreuse de Parme (1839), pour être heureux après une longue période de « sensations insipides », il est nécessaire de « commettre des actes héroïques. » Pour le meilleur ou pour le pire, le culte des héros en temps de guerre est gravé dans la psyché humaine.
Malgré tout, la séparation socioéconomique entre les soldats américains et les reporters américains a été comblée de façon significative – quoique brève – en 2003 pendant l’opération Iraqi Freedom, une offensive terrestre conventionnelle où l’intégration aux unités est devenue le moyen de transport principal de nombreux journalistes. Mais ensuite, lorsque la guerre est devenue non conventionnelle et a paru mal tourner – et lorsque les éditeurs à domicile sont devenus inquiets de l’attitude nouvellement sympathique de leurs employés envers les militaires – les journalistes ont progressivement commencé à rejoindre leur milieu des médias globaux. L’intégration à large échelle qui s’est produite durant l’opération Iraqi Freedom, à présent, semble avoir été une brève parenthèse dans une tendance qui se poursuit.
En effet, les journalistes intégrés utilisant les mots « nous » et « nos » dans leurs récits ont été attaqués par les critiques médiatiques pour avoir fraternisé avec les soldats, mais l’usage de ces mots est totalement approprié pour un Américain vivant pendant des semaines avec des soldats et partageant la plupart de leurs activités. Les correspondants de la Seconde guerre mondiale tels que Richard Tregaskis dans Guadalcanal Diary (1943) et Robert Sherrod dans Tarawa : the Story of a Battle (1944) utilisaient constamment « nous » et « nos ». Ne pas le faire peut être étrange lorsque l’on décrit les effets du soleil, d’une nourriture quelconque ou des balles et des obus tirés sur les troupes et le journaliste qui les accompagne.
Mais le fait que l’usage de ces mots est devenu sensible dans les cercles médiatiques est la preuve de la barrière psychologique qui existe entre le contingent américain des médias globaux et les soldats américains. Les médias américains ne tarissent pas de louanges à l’endroit de ceux qui montrent la vie exclusivement avec la perspective de minorités opprimées, comme John Howard Griffin l’a fait dans Black Like Me (1961), ou des working poors, comme Barbara Ehrenreich dans Nickel and Dimed (2001) ; mais faire de même avec les salariés militaires de l’Amérique revient à risquer la censure.
Par conséquent, dans la prochaine guerre, lorsque les médias fourniront la perspective cosmopolite et globale, les soldats pourraient fort bien fournir eux-mêmes la perspective américaine. C’est un fait que la plupart des fantassins ne supportent pas d’être décrits comme des victimes. La tendance croissante des soldats et Marines américains à décrire leurs expériences et à les mettre en ligne sur des weblogs plutôt que les voir interprétées par des journalistes transnationaux suffit à le prouver. AndrewSullivan.com, parmi d’autres, a régulièrement publié de tels récits. Je me rappelle de l’un d’entre eux, écrit par un aumônier des Marines dans le triangle sunnite, affirmait que le moral des troupes était excellent et suggérait que leur crainte principale était de voir le front intérieur [soit l’arrière de la Première guerre mondiale, note du traducteur] s’effondrer.
Tous les éléments sont en place pour assister à une explosion de ce type de commentaires. Presque tous les soldats ont leurs propres ordinateurs portables et un accès à des cybercafés sur leurs bases. La perspective américaine ne dissimule pas les problèmes et n’embellit pas la situation, mais elle encourage les vertus guerrières et submerge le culte de la victimitude ; elle reconnaît qu’un bon moral ne signifie pas une absence de plaintes – les soldats se plaignent tout le temps, et il serait alarmant qu’ils ne le fassent pas – mais le maintien de l’esprit combattant.
Illégitime et incontrôlable
L’époque médiévale s’est achevée avec le retour de l’autorité. L’Etat français bureaucratique qui a émergé au début du XVIIe siècle, largement grâce au cardinal Richelieu, a graduellement supplanté l’arbitraire individuel des barons féodaux. Son prédécesseur était le solide Etat sicilien créé par le monarque normand Roger II de Hauteville qui, cinq siècles plus tôt, avait employé l’absolutisme à des fins libérales en protégeant ses citoyens contre l’idéalisme primitif associé avec la vaste et inefficace universalité du pape.
Comparer les médias globaux avec une telle universalité serait une exagération. Toutefois, la comparaison avec le passé est tout ce dont nous disposons. Je fais la suggestion que les médias globaux deviennent un vernis frais et inefficace d’autorité morale comme celui du pape au Moyen-Age. Néanmoins, il est suffisamment réel pour étouffer et influencer l’autorité plus légitime héritée d’un électorat – et qui est ancrée dans une zone géographique précise.
Notre souci de promouvoir la démocratie est un peu déplacé. Des sociétés davantage libres émergent de toute manière. Même au Moyen-Orient, la nouvelle génération de dirigeants n’aura pas le loisir de régner de manière aussi autocratique que la précédente. Le tumulte social et le changement économique doivent être gérés, et non enflammés. Mais un autre genre de tyrannie fait son apparition. C’est une foule qui m’inquiète – non élue, incontrôlable, qui passe d’un lynchage à l’autre, se bat entre elle, se disperse, s’effondre puis se regroupe sans cesse. Elle ne peut jamais se tromper, parce que sa cause est celle des faibles et des opprimés. Et c’est là que réside le pouvoir de l’oppression.
Texte original: Robert D. Kaplan, "The Media and Medievalism", Policy Review, December 2004 and January 2005
Traduction et réécriture: Lt col EMG Ludovic Monnerat
© 1998-2004 CheckPoint |